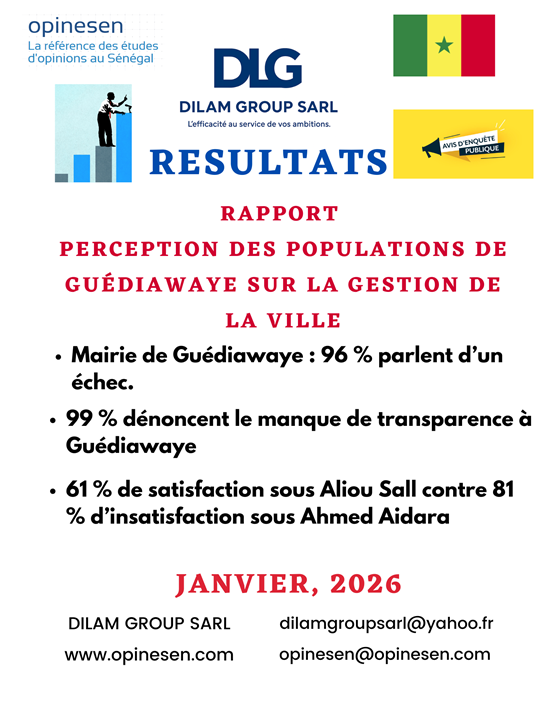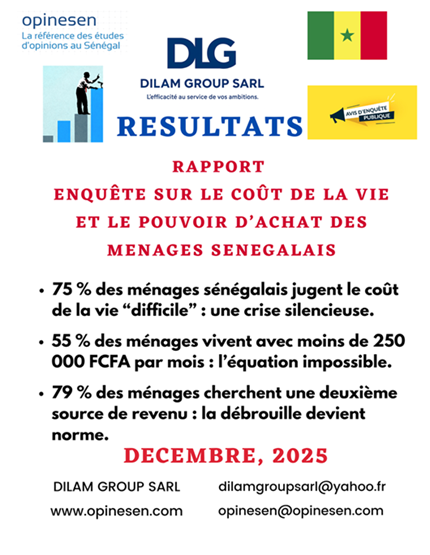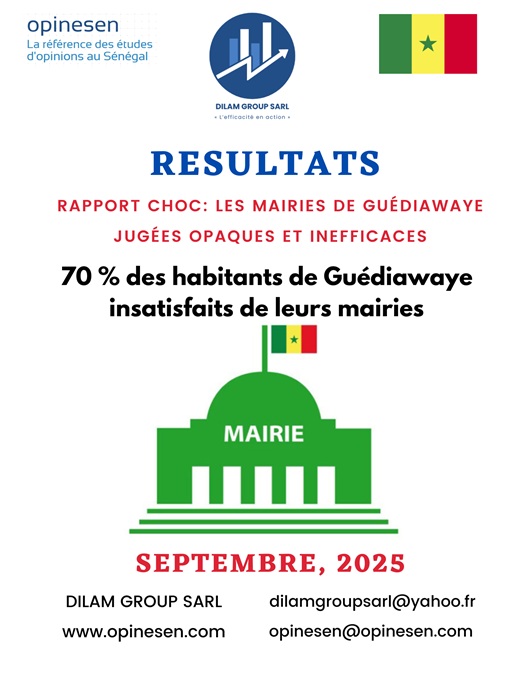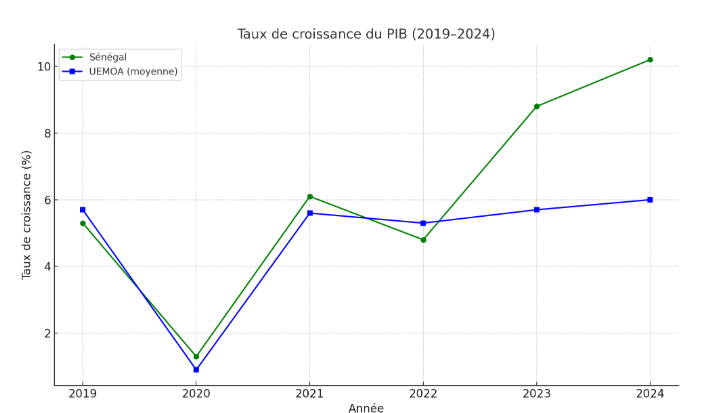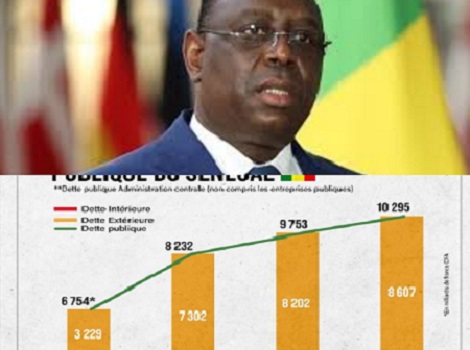Gestion municipale à Guédiawaye : une enquête révèle un rejet massif de l’équipe actuelle.
Une récente enquête menée auprès de 432 habitants de Guédiawaye, entre le 20 et le 30 décembre 2025, dresse un constat sans appel sur la perception de la gestion municipale actuelle dirigée par Ahmed Aidara. Les résultats montrent une crise profonde de confiance, marquée par une forte nostalgie de la gouvernance précédente assurée par Aliou Sall. Un rejet quasi unanime de la gestion actuelle Selon les données de l’enquête, 81 % des personnes interrogées se disent “pas du tout satisfaites” de la gestion municipale actuelle. À cela s’ajoutent 13 % de “peu satisfaits”, portant à 94 % le taux global d’insatisfaction. À l’inverse, seuls 3 % des répondants jugent la gestion actuelle satisfaisante. Plus alarmant encore, 96 % des habitants estiment que la situation de la ville s’est dégradée depuis l’arrivée de la nouvelle équipe municipale. Aucun répondant n’a évoqué une amélioration. L’ancienne équipe largement préférée La comparaison avec la gestion de l’ancien maire Aliou Sall est particulièrement défavorable à l’équipe en place. 89 % des répondants estiment que l’ancienne équipe gérait mieux la mairie, contre seulement 3 % qui préfèrent l’équipe actuelle. Aucun sondé ne considère que les deux équipes se valent. La gestion précédente bénéficie d’un taux de satisfaction globale de 61 %, notamment grâce aux actions sociales (97 % d’opinions positives), aux infrastructures (67 %) et à une présence municipale jugée plus visible sur le terrain. Gouvernance et transparence au cœur des critiques L’enquête révèle que la principale source de mécontentement ne réside pas uniquement dans l’état des infrastructures ou la propreté, mais surtout dans la gouvernance.Ainsi, 99 % des répondants critiquent la gouvernance et le manque de transparence de l’équipe actuelle. La sécurité, les infrastructures et la gestion des déchets sont également pointées du doigt par 83 % des habitants. Pour beaucoup, le problème est moins politique que gestionnaire : une mairie jugée opaque, peu communicante et distante des populations. Un regret du changement, mais pas idéologique La moitié des répondants (50 %) expriment un regret fort du départ d’Aliou Sall, tandis que 34 % n’en expriment aucun. Cette donnée traduit un regret comparatif, lié davantage à la déception actuelle qu’à une adhésion inconditionnelle à l’ancien maire. Des attentes claires des populations Les habitants de Guédiawaye réclament avant tout : Un signal politique fort Au-delà des chiffres, cette enquête envoie un message clair aux autorités locales : à Guédiawaye, le changement de leadership municipal est perçu par une large majorité comme un recul. Pour de nombreux observateurs, ces résultats constituent un signal d’alerte politique majeur, annonçant une possible sanction électorale si des corrections rapides et crédibles ne sont pas engagées OPINESEN / DILAM GROUP